
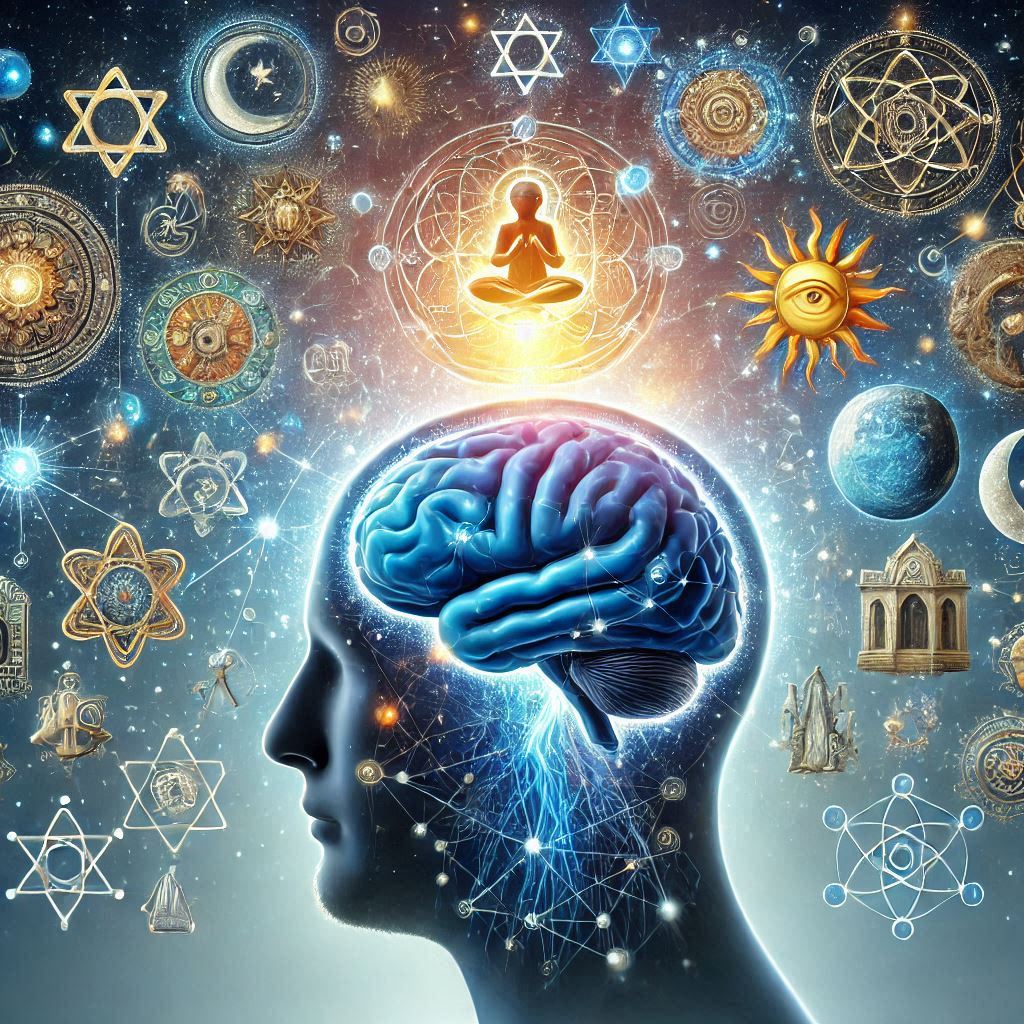
Qu’est-ce que la neurothéologie ?
La relation entre la science et la spiritualité a toujours été un sujet de débat et d’exploration. À une époque où ces deux sphères semblent de plus en plus se rapprocher, la neurothéologie apparaît comme un domaine de recherche innovant qui cherche à établir des liens entre les pratiques spirituelles et les mécanismes neurologiques. Des chercheurs reconnus tels qu’Andrew Newberg, Eugene D’Aquili, et le Dr. Besson apportent des éléments essentiels à cette discussion.
La question principale autour de la neurothéologie est la suivante : qu’est-ce qu’il se passe dans notre esprit lorsque nous prions, méditons ou lorsqu’on vit des expériences spirituelles profondes ?
Les origines de la neurothéologie
Le terme « neurothéologie » a été introduit pour la première fois par Aldous Huxley en 1962, l’auteur du roman « Le Meilleur des Mondes ». Huxley a introduit l’idée de relier les dimensions neurologiques et spirituelles de l’expérience humaine. Cependant, c’est en 2001 que ce concept a gagné en popularité grâce aux travaux d’Andrew Newberg, un neuroscientifique de l’Université de Pennsylvanie. Dans son livre « Why God Won’t Go Away » (Pourquoi Dieu ne disparaîtra pas), Newberg explore comment la prière, la méditation et d’autres pratiques religieuses activent des zones spécifiques du cerveau. Ses recherches démontrent que la foi et la spiritualité ne sont pas seulement des constructions idéologiques, mais qu’elles engagent des mécanismes neurobiologiques profonds.
Les effets de la Méditation étudiés par la science
Les études sur les effets de la méditation révèlent des impacts significatifs sur le cerveau et le corps. Les recherches montrent que la méditation influence le système neurovégétatif, améliorant ainsi la fréquence cardiaque et réduisant le stress. Elle modifie aussi les niveaux de neurotransmetteurs, ce qui contribue à diminuer l’anxiété et la dépression. Andrew Newberg et son collègue Eugene d’Aquili ont observé que lors d’états de profonde méditation, certaines régions du cerveau, comme le lobe pariétal, voient leur activité diminuer tandis que le cortex préfrontal droit, responsable de l’attention et de la concentration, s’active. Cela pourrait expliquer pourquoi les méditants ressentent une dissolution de leur individualité et un sentiment d’unité avec l’univers.
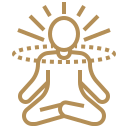
Des nonnes sous observation
Les recherches menées par Mario Beauregard sur des religieuses carmélites ont également fourni des résultats intéressants. Lors d’états de prière intense, appelés « union mystique », les nonnes ont montré une activation significative dans certaines régions du cerveau associées à l’attention et à l’émotion. Ces études mettent en lumière comment des expériences spirituelles profondes peuvent influencer notre activité cérébrale, notamment à travers l’activation du noyau caudé, une région liée à l’apprentissage et à l’amour inconditionnel.
Quand la spiritualité soigne le mental des addicts
Pour des chercheurs comme le Dr. Jacques Besson, psychiatre suisse, la spiritualité n’est pas seulement une question de croyance religieuse, mais un besoin naturel et universel chez l’humain. Ancien médecin à l’Armée du Salut, le Dr. Besson a consacré sa carrière à étudier l’impact de la spiritualité sur les personnes souffrant d’addictions. Ses recherches démontrent que la spiritualité peut servir de facteur protecteur contre les addictions.
Il a notamment observé que de nombreux alcooliques réussissaient à surmonter leurs dépendances en participant à des groupes tels que les Alcooliques Anonymes, qui se positionnent comme des mouvements spirituels sans connotation religieuse.
Cette approche montre que la quête spirituelle peut être essentielle pour ceux qui cherchent à surmonter leurs luttes personnelles. Le concept de salutogenèse développé par Aaron Antonovsky renforce cette idée en se concentrant sur les facteurs qui favorisent la santé plutôt que sur ceux qui causent des maladies. La spiritualité émerge comme un attracteur clé pour le bien-être physique et mental.
Conclusion
La neurothéologie représente un domaine de recherche prometteur qui se situe au croisement entre la science et la spiritualité. Les travaux des différents scientifiques mentionnés éclairent notre compréhension des expériences spirituelles et leurs impacts sur notre cerveau.
Si vous vous intéressez à ce sujet, je vous encourage à expérimenter les pratiques mentionnées comme la méditation et la prière, et surtout n’hésitez pas à partager vos expériences avec les autres, dans le forum Esotera.
Mon avis
Personnellement, je suis d’avis que ces nouveaux pans de recherche scientifique pourraient bien transformer notre perception des relations entre la science et la spiritualité et nous diriger vers une vie équilibrée et davantage ouverte aux possibilités. Elle servirait vraiment de pont entre deux mondes qui traditionnellement semblent plutôt opposés. D’autre part, la neurothéologie montre comment des expériences mystiques qui sont souvent vues comme irrationnelles peuvent avoir une base neurologique clairement identifiable. Elle vient aussi ouvrir des pistes pour comprendre pourquoi certaines pratiques spirituelles apportent des bénéfices pour la santé mentale et le bien-être et ainsi, crédibiliser ces pratiques et bien d’autres encore.
La neurothéologie a bien sûr ses limites, elle risque par moments de réduire les expériences spirituelles à de simples processus neurologiques. Et c’est là, où il faut faire attention. On ne peut pas tout réduire à notre cerveau.
On le sait, la quête de sens est importante pour les êtres humains et elle mérite d’être davantage étudiée et explorée à travers les prismes de la science. Grâce à la neurothéologie on a peut-être enfin, la possibilité d’un nouveau terrain de dialogue entre science et spiritualité.

Et de votre côté ?
- En quoi les découvertes de la neurothéologie modifient-elles votre perception de la spiritualité et de la pratique religieuse ?
- Pensez-vous que les sciences et la spiritualité peuvent coexister harmonieusement, ou voyez-vous un conflit entre ces deux domaines ?

Sources
Pour aller plus loin, voici les sources :
Livres
- « Pourquoi Dieu ne disparaîtra pas : Neurosciences et expérience religieuse » de Andrew Newberg et Eugene D’Aquili
- « How God changes our brain » d’Andrew Newberg et Mark Robert Waldman
- « Addiction et spiritualité » de Jacques Besson
- « The Spiritual Brain: Science and Religious Experience » par Mario Beauregard et Denyse O’Leary
Articles scientifiques
- Are we Wired for Spirituality? An Investigation Into the Claims of Neurotheology
https://www.researchgate.net/publication/328027943_Are_we_Wired_for_Spirituality_An_Investigation_Into_the_Claims_of_Neurotheology - Neurotheology: How science can enlighten us about spirituality.
https://psycnet.apa.org/record/2018-19502-000 - The Neural Correlates of Religious and Nonreligious Belief
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0007272 - Searching for God in the Brain
https://www.scientificamerican.com/article/searching-for-god-in-the-brain - Reward, salience, and attentional networks are activated by religious experience in devout Mormons
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17470919.2016.1257437
Author: Patricia Morgado
Hello ! Je suis Patricia, la fondatrice d'Esotera et la voix du Podcast Esprit Sérendipité. Je suis disponible à la moindre question, par e-mail : contact@esotera.fr
